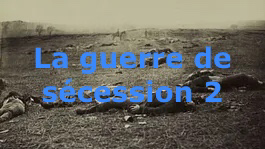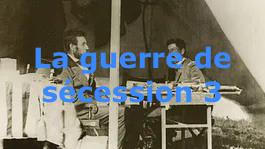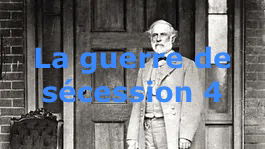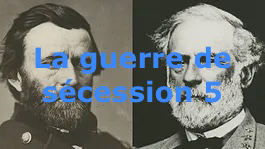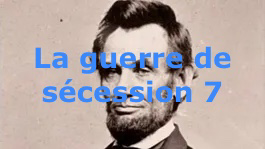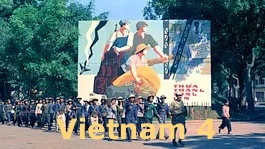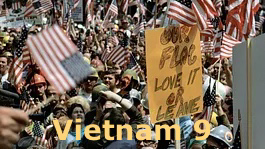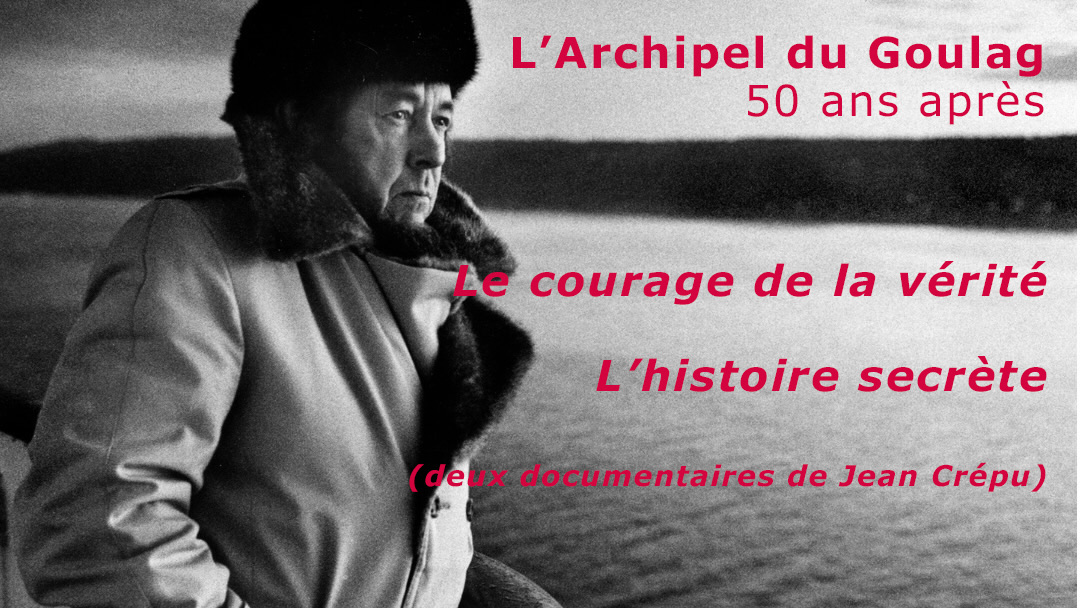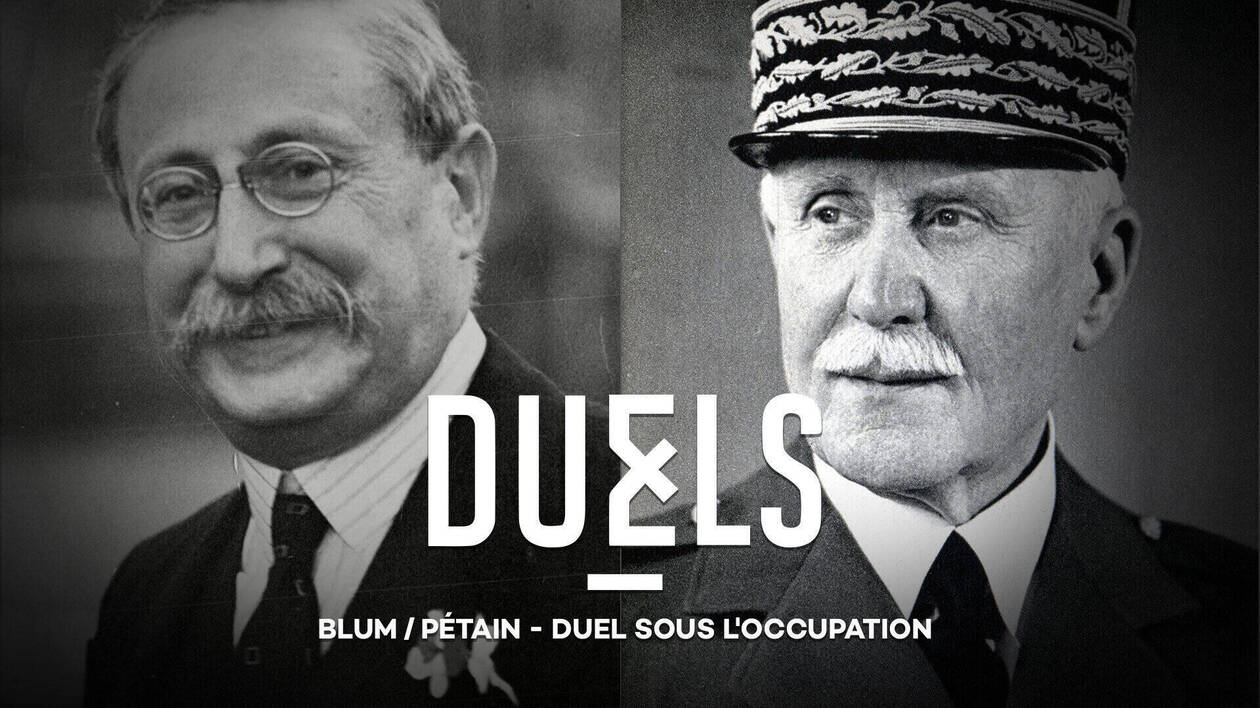Vingt et trois étrangers et nos frères pourtant
Film documentaire réalisé par Mosco Levi Boucault en 2024 sur les membres de l'Affiche rouge en postface des Terroristes à la retraite (1985)
À l'occasion de l'entrée au Panthéon des cendres de Missak Manouchian et de son épouse Mélinée, ce 21 février 2024, quatre-vingts ans jour pour jour après l’exécution du résistant au mont Valérien avec vingt-et-un de ses compagnons, Mosco Levi Boucault rend, avec cette postface de son documentaire "Des terroristes à la retraite", un vibrant hommage aux combattants de l’Affiche rouge.
Ils s’appelaient Raymond Kojitsky, Rino Della Negra, Thomas Elek, Olga Bancic, Celestino Alfonso… Ils étaient membres des Francs-tireurs et partisans - Main-d’oeuvre immigrée (FTP-MOI), unités de la résistance communiste. Sous l’impulsion du PCF, ces résistants, juifs et étrangers, dont Missak Manouchian, ont pris les armes contre l’occupant allemand à Paris de 1942 à novembre 1943 et joué un rôle déterminant dans la Résistance. Après l’assassinat du colonel SS Julius Ritter, qui supervisait le STO (Service du travail obligatoire), le 28 septembre 1943, vingt-trois d'entre eux sont arrêtés en novembre et vingt-deux exécutés le 21 février 1944. Olga Bancic, la vingt-troisième, sera guillotinée à Stuttgart. Une "affiche rouge" avec les noms de dix d’entre eux est alors placardée sur les murs de France par la propagande nazie, attribuant les actes de résistance à une armée de criminels étrangers, juifs et communistes.
Bribes de vies héroïques
À l’occasion du 80e anniversaire de l'exécution de Missak Manouchian et de sa panthéonisation le 21 février 2024, en compagnie de son épouse Mélinée (disparue en 1989), Mosco Levi Boucault réalise, avec la cinéaste Ruth Zylberman, une postface de son documentaire Des terroristes à la retraite sorti en 1985, qui emprunte son titre au poème L'affiche rouge d'Aragon leur rendant hommage. Parcourant Paris et sa banlieue, Ivry et Saint-Ouen, les auteurs brossent le portrait de cinq de ces résistants des FTP-MOI – quatre hommes et une femme. Grâce aux émouvants témoignages de leurs descendants (petits-enfants, neveux, arrière-petits-enfants) lisant leurs dernières lettres ou évoquant des bribes de ces vies héroïques, et aux analyses précieuses des historiens Annette Wieviorka et Thomas Fontaine, ils restituent la mémoire de ces combattants qui alliaient amour de la France et haine du fascisme, tous morts pour la liberté dans l’espoir de lendemains qui chantent.